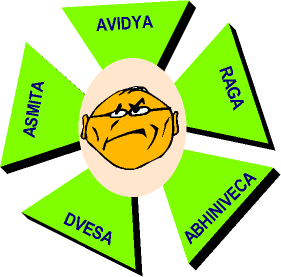|
 |
| FORUM |
|
3/8
Le
troisième des obstacles dans la pratique du yoga se trouve dans
les obscurités de notre subconscient qui nous font agir de manière
irrai-sonnée, par "habitude", et conditionne nos
inclinations psychologiques (joie, peine, peur, colère,
etc...). C'est
la pratique des exercices psychiques qui dénouera un à un
ces conditionnements.
En partant des trois obstacles précédents, le Samkhya a synthétisé cinq matrices de contraintes :
- Avidya (ignorance), c'est l'identification de l'esprit à l'extériorité.
- Asmita (individualité), c'est l'idée d'être un moi séparé et autonome.
- Raga ( attachement), conséquence d'Asmita c'est l'idée d'appropriation des expériences et des objets.
- Dvesa (dégoût), c'est le jeu malsain de l'attrait et de la répulsion, ce que nous voulons, ce que nous aimons, ce que nous ne voulons pas, ce que nous haïssons.
- Abhiniveca (volonté de vivre), c'est le besoin de croire notre personne "image irréelle" éternelle, et en conséquence de rechercher pour elle un bonheur sans cesse fugitif.
Le Samkhya est athée, dans le sens que l'idée de divinité n'est pas évoquée. En conséquence, le YOGA est athée.
Toutefois, l'homme conditionné a quelques difficultés à accepter cette idée d'athéisme qui est un frein à son enthousiasme, par l'absence de support à son aspiration. L'idée de "non-divinité", reconnue mentalement reste encore une "divinité".
Conscient de cette difficulté psychologique, les yogis ont inventé de toutes pièces un Dieu pour les apprentis-disciples. Ce Dieu est appelé ISHVARA, une sorte de support de travail, qui est évoqué avant chaque séquence yoguique.
La théisme dans le Yoga a fait son apparition de manière tardive, sous l'influence forte de la Bhagavad-Guita. Citons un yoga exclusivement théiste, la Bhakti yoga, celui de la dévotion ou de la religiosité.
Il est toutefois utile de rappeler que même dans la démarche dévo-tionnelle, la vision de la divinité n'est pas semblable à l'idée qui en est faite en occident.
Le grand Ramakrishna tout Bhakti yogi qu'il fut dût en final passer par l'aridité du vide de l'athéisme (advaita vedanta) pour atteindre la conscience totale de Brahman.
Les nuances indiennes sur la divinité et la religiosité - bien différentes de celles d'occident - doivent être prises en compte pour mieux en apprécier les subtilités.
Notons enfin que certains adeptes, Samkhya purs et durs n'admettent pas l'incursion des ajouts divins dans leurs pratiques yoguiques, et qu'his-toriquement, la Bhagavad guita eut en Inde dans les siècles récents un tel impact qu'il a été facile de joindre du théisme dans tout ce qui touchait le Yoga.
A la base, rappelons-le, il n'en est rien, même si cet apport est toléré.
|
|
|
Ecrire | inscrire son site | Demandes d'infos | SHRIAUROBINDO en FAVORI | Copyright 1998 - 2002 © CENTRE SHRI AUROBINDO FRANCE - LE MANS |
| Menu | |
|
|
|
 |
|